Psychologie et santé des femmes : quand la recherche change de visage
- Rachel Ferrere

- 5 sept.
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 6 sept.
Introduction
Pourquoi la recherche en psychologie et santé des femmes est-elle si importante ? Parce qu’elle ne se contente pas de combler un vide scientifique : elle transforme la science elle-même.
Pendant longtemps, les femmes ont été absentes des protocoles de recherche. Les résultats obtenus auprès d’hommes étaient généralisés à toute la population. Résultat : des pathologies féminines comme l’endométriose, la dépression post-partum ou les maladies gynécologiques comme l'endométriose ont été mal comprises, mal diagnostiquées et mal traitées.
Aujourd’hui, ce champ de recherche révèle les biais hérités de cette histoire et propose de nouvelles façons de faire de la science : plus inclusives, plus sociales, et surtout plus attentives à la diversité des expériences.
Les angles morts de la science traditionnelle
La recherche biomédicale et psychologique a longtemps souffert de trois biais majeurs :
L’androcentrisme : l’homme a servi de norme, reléguant les expériences féminines au rang de particularités.
L’ethnocentrisme : les références occidentales ont été érigées en universelles, invisibilisant les vécus féminins dans d’autres contextes culturels.
Le positivisme exclusif : en voulant tout mesurer, la science a parfois aplati la complexité du vécu féminin en indicateurs simplifiés.
Ces angles morts ont limité la compréhension des femmes en tant que patientes et freiné le développement de modèles de santé adaptés à leurs réalités psychologiques, sociales et culturelles.
L’évolution des paradigmes : un chemin en quatre temps
1. Le positivisme : la rigueur des chiffres
Le positivisme a permis de poser des bases solides en objectivant la réalité biologique.
Exemple : dans l’endométriose, les études biomédicales ont montré l’inflammation, l’hypersensibilisation centrale et les comorbidités (troubles du sommeil, infertilité). Ces résultats ont permis de sortir d’un discours réducteur qui accusait les femmes d’“exagérer” leur douleur (Berkley & Taylor, 2013).
2. Le postpositivisme : reconnaître les biais
Le postpositivisme a ajouté une nuance essentielle : toute recherche comporte des biais, et aucune vérité absolue n’est atteignable.
Exemple : dans le cancer du sein pendant la grossesse, les statistiques de survie et de réponse thérapeutique sont complétées par des données qualitatives. Ces récits montrent que l’annonce et le vécu de la maladie varient selon le projet maternel, le soutien familial et le contexte social (Amant et al., 2012). Les données qualitatives permettent une meilleure compréhension des résultats quantitatifs et plus de nuance dans les interrétations des données (Ferrere et Wendland, 2013, 2015 et 2021)
3. Le constructivisme : donner place aux récits et aux contextes
Le constructivisme rappelle que la santé est une expérience co-construite par les récits, les cultures et les contextes. Elle permet en outre de penser l'intersectionnalité.
Exemple : une grossesse à risque n’est pas vécue de la même manière en France hexagonale ou en Martinique. Le rapport au corps, à la maternité et au soin est façonné par des histoires collectives et des contextes culturels spécifiques (Charron-Prochownik et al., 2014 ; Condé, 2010).
4. Les approches féministes : dévoiler les rapports de pouvoir
Enfin, les approches féministes ont mis en lumière le rôle des rapports de domination dans la production scientifique.
Exemple : la banalisation de la douleur menstruelle (“c’est normal d’avoir mal pendant ses règles”) a contribué au retard diagnostique de l’endométriose (7 à 10 ans en moyenne) (Seear, 2009).
Un dialogue nécessaire entre paradigmes
L’innovation actuelle n’est pas de remplacer un paradigme par un autre, mais de les croiser :
le positivisme pour sa rigueur,
le postpositivisme pour sa reconnaissance des biais,
le constructivisme pour sa valorisation des récits,
les approches féministes pour leur critique des rapports de pouvoir.
C’est cette épistémologie hybride qui permet d’intégrer à la fois données objectives, subjectivité des patientes, ancrages culturels et justice épistémique.

Ce que la psychologie apporte
La psychologie est un maillon central de cette transformation :
Donner voix aux patientes :Là où la biomédecine mesure les symptômes, la psychologie explore la manière dont les femmes vivent leur maladie. Elle met en lumière la subjectivité, souvent réduite au silence.
Articuler corps, émotions et culture :La psychologie de la santé éclaire les interactions entre douleur, stress, représentations sociales et trajectoires de vie. Par exemple, comprendre comment la banalisation culturelle de la douleur menstruelle entretient le retard diagnostique de l’endométriose.
Comprendre l’adaptation psychologique :Mes travaux sur le cancer en période périnatale montrent comment maternité et maladie s’entrecroisent, générant des tensions identitaires profondes. Être malade au moment où l’on devient mère exige des mécanismes psychiques complexes (déni, minimisation, dissociation) qui influencent directement l’ajustement à la maladie (Ferrere & Wendland, 2021).
Proposer des outils concrets :La psychologie ne se limite pas à analyser : elle développe des programmes d’accompagnement, comme les interventions psycho-éducatives, la thérapie cognitivo-comportementale, l’hypnose encore les approches psychocorporelles. Ces outils aident les femmes à mieux vivre avec la douleur chronique, à réduire l’anxiété et à retrouver un sentiment d’empowerment.
La psychologie, en dialogue avec les autres disciplines, permet donc :
des diagnostics plus sensibles,
des soins plus adaptés,
et une reconnaissance pleine du vécu féminin.
Elle permet aussi de comprendre ce qui se joue pour les soignants et les enjeux de la relation soignant/soigné, permettant de meilleures formations et de meilleurs accompagnements.
Mes travaux : vers une recherche intégrée et située
Ferrere & Wendland (2021) — Psychological Adjustment in the Context of Perinatal Cancer
Cette étude postpositiviste met en lumière un ajustement psychique complexe chez les mères atteintes de cancer pendant la grossesse. Le déni, le sentiment de ne pas pouvoir être mère tout en malade, et la difficulté à conjuguer maternité et traitement sont des vécus cliniques identifiés à travers un instrument quantitatif (MAC44) et des entretiens semi-directifs
Ces recherches contribuent à ce mouvement plus large : celui d’une science qui ne se contente pas de décrire, mais qui change de visage en intégrant la diversité des expériences féminines.
Conclusion
La recherche en santé des femmes n’est pas seulement un champ émergent. Elle est un laboratoire épistémologique où se réinventent les manières de produire du savoir.
De l’endométriose au cancer en grossesse, des douleurs chroniques à la dépression post-partum, chaque étude nous rappelle que croiser les paradigmes est la seule manière de rendre justice à la complexité des expériences féminines.
La santé des femmes, longtemps invisibilisée, devient aujourd’hui un moteur de transformation de la science.
Références
Amant, F., Loibl, S., Neven, P., Van Calsteren, K., et al. (2012). Breast cancer in pregnancy: Recommendations of an international consensus meeting. European Journal of Cancer, 48(18), 3155–3168.
Berkley, K. J., & Taylor, R. N. (2013). The influence of endometriosis on pain. Clinical Obstetrics and Gynecology, 56(1), 102–110.
Charron-Prochownik, D., et al. (2014). Cultural influences on pregnancy and diabetes self-management in women with preexisting diabetes. The Diabetes Educator, 40(6), 763–773.
Condé, M. (2010). Corps et mémoire dans les sociétés antillaises. Revue Carbet, 10, 45–60.
Ferrere, R., & Wendland, J. (2021). Psychological Adjustment in the Context of Perinatal Cancer. [Étude exploratoire sur l’adaptation psychologique des femmes atteintes de cancer en période périnatale]
Ferrere, R., & Wendland, J. (2015). Les enjeux psychologiques des cancers diangostiqués au cours de la période périnatale. Le devenir mère. à l'épreuve du cancer. Thèse de doctorat de psychologie. Université Paris Descartes PRES Sorbonne.
Seear, K. (2009). The etiquette of endometriosis: Stigmatisation, menstrual concealment and the diagnostic delay. Social Science & Medicine, 69(8), 1220–1227.
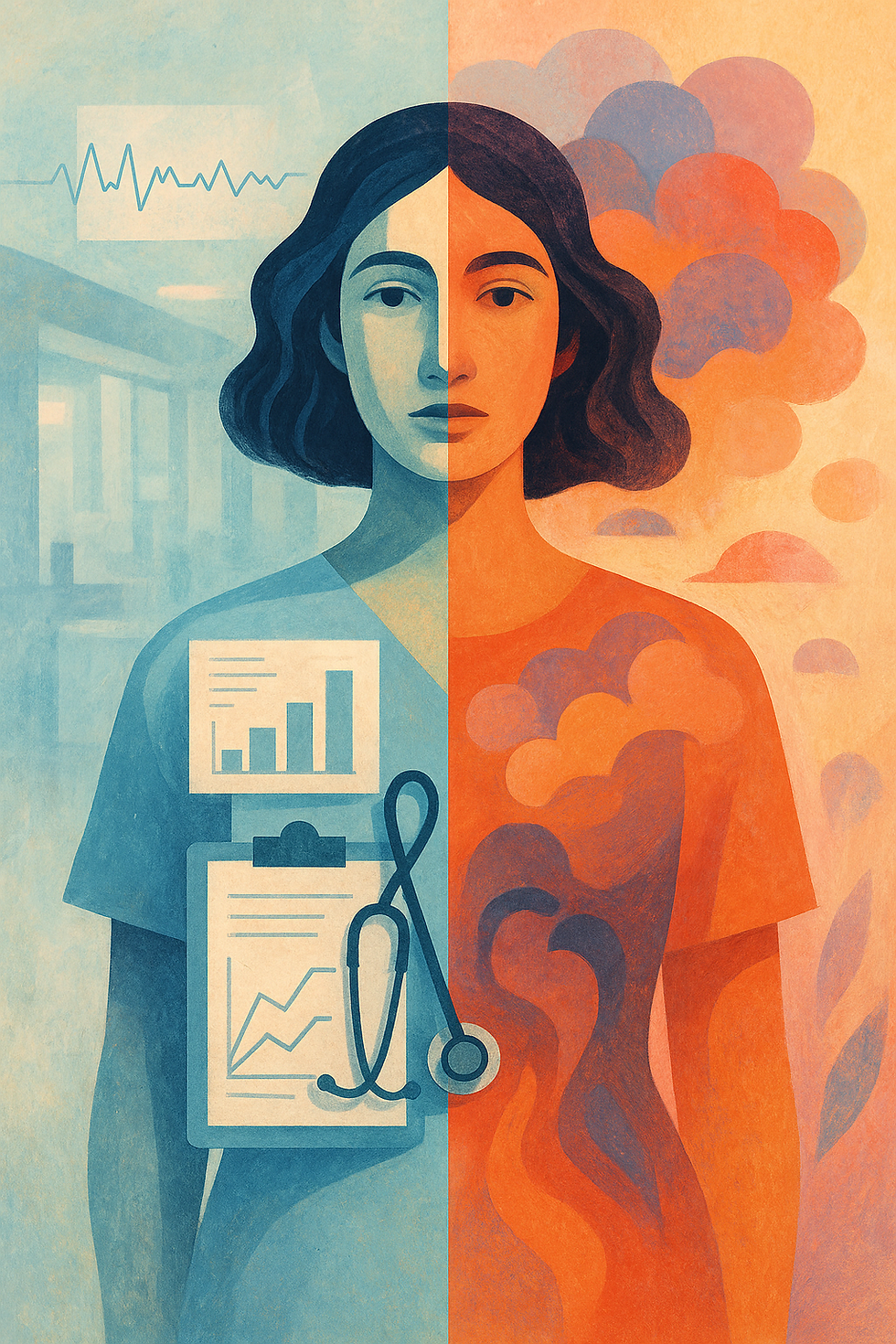



Commentaires